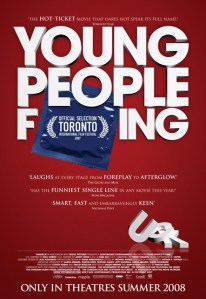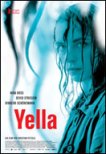Continental, un film sans fusil
Un homme se réveille dans un autobus immobilisé et déserté au beau milieu de nulle part, sur le bord d’une route. Il fait nuit. Il descend, hagard. Des bruits étranges se font entendre. Puis, inexplicablement, il s’enfonce dans la forêt environnante.
C’est ainsi que débute, de manière énigmatique, presque fantastique, ce singulier premier long métrage de Stéphane Lafleur, couronné de louanges et de prix lors de son passage aux prestigieux festivals de Venise, de Toronto et de Namur. Et quel plaisir de se retrouver devant une véritable oeuvre, d’une maturité étonnante pour un si jeune cinéaste qui a déjà fait ses armes comme monteur, réalisateur de courts métrages et chanteur-guitariste au sein de la formation folk-lo-fi Avec pas d’casque. Lent, minimaliste, contemplatif et résolument anti-commercial, Continental, un film sans fusil fait figure d’exception au sein du paysage cinématographique québécois, trop souvent platement consensuel et télévisuel. C’est tout le contraire ici, et on s’en réjouit.
Si on veut trouver un proche parent québécois à ce Continental, ce serait peut-être Sur la trace d’Igor Rizzi, qui avait révélé un autre jeune talent très prometteur en la personne de Noël Mitrani. Les deux films partagent un souci similaire d’épure, une approche minimaliste aux accents européens ainsi qu’une profonde mélancolie. Mais tandis que le film de Mitrani jongle avec les codes du film de genre, celui de Stéphane Lafleur est tout entier campé dans la banalité morose d’une réalité quotidienne d’où émane le terrible poids de la solitude et de l’ennui, thématiques centrales du film.
Continental se construit en un enchaînement de vignettes réunissant quatre personnages principaux aux prises avec l’aliénation de leur vie sans éclat et avec les vicissitudes qu’ils traversent sur les plans professionnel et personnel. Lucette (Marie-Ginette Guay), une hygiéniste dentaire, vit difficilement la disparition soudaine de son mari. Louis (Réal Bossé) tente de devenir vendeur d’assurances et doit vivre dans un hôtel, éloigné de sa famille. Chantal (Fanny Malette), réceptionniste à ce même hôtel, est une jeune fille maladroite qui souffre de solitude chronique. Enfin, Marcel (Gilbert Sicotte) est aux prises avec un problème de dents qui le confronte à ses difficultés financières et à la vieillesse qui le gagne.
Quatre individus ordinaires, petites gens malhabiles dans leur manière de communiquer et d’interagir avec les autres, souffrant des affres provoquées par la monotonie de leur existence, un peu pathétiques dans leurs gestes dérisoires et leurs paroles hésitantes, souvent seuls avec eux-mêmes. Leurs pas vont se croiser, par hasard, le temps d’un rapprochement magnifiquement symbolisé par le titre, et renvoyant à cette danse quétaine qui cristallise l’état de leurs aléas, parallèles et synchronisés dans leur petitesse et leur détresse, à proximité d’autrui mais confinés à leur solitude, dans un élan morne, témoin de leur lassitude et du fardeau de leur condition, et qui ne permet aucun véritable contact.
Mais le regard que porte le cinéaste sur ces quatre individus anonymes et modestes est dénué de toute forme de jugement et de cynisme. Il est tout au contraire imprégné d’une grande tendresse et d’un profond sens de la compassion. Et c’est là que se situe toute l’originalité de la démarche de Lafleur. Car si on décèle de nombreuses influences à l’oeuvre dans Continental, le film a le mérite de se distinguer de celles-ci au moyen d’un ton résolument personnel. Certes, l’approche formelle témoigne d’une sensibilité cinématographique davantage européenne que nord américaine. Lafleur a certainement fréquenté l’oeuvre d’Aki Kaurismaki, de Roy Andersson et d’Ulrich Seidl, pour ne nommer qu’eux, car le choix esthétique de longs plans fixes, des situations captant le malaise et l’inconfort, de la construction fragmentée en une série de tableaux composés avec un soin remarquable et du ton mâtiné d’absurde de l’ensemble renvoient à ces trois modèles, ainsi que plus largement à tout un pan du cinéma scandinave.
Lafleur s’inscrit d’emblée au sein de cet héritage que d’aucuns qualifieront d’austère, mais qui apporte une grande rigueur et une incroyable pertinence à son travail de réalisation. D’un professionnalisme remarquable, la mise en scène tire une grande force expressive de l’immobilité du cadre. Très personnelle malgré ses sources d’inspiration évidentes, la signature de Lafleur est perceptible dans chacun des plans magnifiquement photographiés par Sara Mishara. Son sens du détail tant sonore que visuel est foudroyant. Son oeil s’attarde sur tous les menus détails anodins qui sont pourtant les plus puissants révélateurs du drame intérieur de chacun des personnages : des gros plans sur un dentier, une photo rafistolée, un répondeur brisé, une carte d’affaires avec une faute, chacun des objets et des éléments du décor dévoile l’émotion et un aspect de la personnalité de son détenteur avec une justesse exceptionnelle. Le travail sonore est encore plus stupéfiant. Les bruits avoisinants, les musiques environnantes – le plus souvent abrutissantes – et la cacophonie ambiante sont enregistrés avec une acuité ininterrompue. Seules quelques notes occasionnelles viennent s’ajouter en de rares moments à cette composition auditive hyperréaliste et absolument brillante, qui constitue à elle seule l’un des traits les plus insolites et inventifs du film.
J’ai mentionné plus tôt l’héritage filmique nordique que porte Continental. Le film de Lafleur est toutefois profondément ancré dans la spécificité québécoise, plus particulièrement dans la vie de banlieue, qu’il évoque avec une précision impressionnante. On reconnaît immédiatement ces bazars poussiéreux et figés dans une époque révolue, ces hôtels de bord d’autoroute, ces musiques complètement ringardes et ces bribes de conversation approximatives qui témoignent de la grande authenticité de la démarche de Lafleur. Un grand sens de l’humour – celui qui permet d’éviter de sombrer dans le désespoir – traverse le film, tout en absurdité et en finesse, loin des gags abrutis d’humoristes imbéciles que le cinéma québécois nous dessert trop souvent. Un brin caustique, illustrant le caractère ridicule des situations, son trait comique ne se prolonge jamais jusqu’à atteindre une verve décapante ou cinglante. Car c’est avec une sincère émotion que ses personnages sont captés dans leurs mésaventures et leurs faux pas. Aussi, le rire vire souvent au jaune, ou se distille lentement lors d’une scène, le temps que l’on saisisse un détail qui fait surgir notre sourire.
Il ne faut donc pas se surprendre de voir le film noyé sous une chape grise et tristounette, comme ce climat automnal qui s’abat sur ces âmes errantes. Une mélancolie jamais appuyée, à peine perceptible sous les traits fatigués de ces quatre personnages en mal d’une bouée de sauvetage et qu’ils ne parviennent pas à trouver. Les dialogues, impeccables et réduits au minimum, attestent eux aussi de la lassitude morale des personnages, confinés à un registre platement insignifiant qui les empêche de véritablement communiquer les uns avec les autres. Prisonniers des lieux communs du discours, renforcés et révélés par l’omniprésence des paroles vides de la télé et de la radio que l’on entend souvent en arrière-plan, ils tentent un rapprochement, puis se rétractent, à la manière de la danse du titre.
Tout cela est rendu par un formidable quatuor d’acteurs qui ont parfaitement compris le ton unique du film de Lafleur et qui proposent des compositions tout simplement remarquables. Gilbert Sicotte est particulièrement émouvant et méconnaissable dans un rôle fragile et intériorisé qui nous fait sentir toute la tragédie du sentiment de vieillir. Fanny Malette est parfaite en jeune femme un peu timide et gauche, tandis que Réal Bossé fait des merveilles avec son personnages d’apprenti vendeur d’assurances et que Marie-Ginette Guay étonne dans le rôle de l’épouse éplorée. Les rôles secondaires sont tout aussi réussis et savoureux, notamment celui interprété par Marie Brassard.
Grâce à la qualité de l’interprétation et à la brillante précision de la mise en scène, il se dégage ainsi une grande humanité de ce film triste mais sans excès, dénué de la moindre fausse note, et qui frappe en plein coeur. Continental est une remarquable réussite cinématographique et l’un des meilleurs et plus originaux films québécois des dernières années. Il marque la naissance d’un cinéaste qu’on suivra certainement de très près.