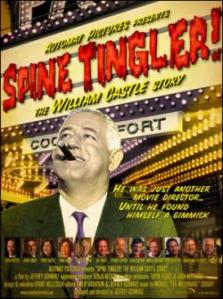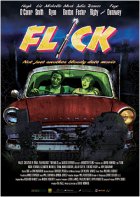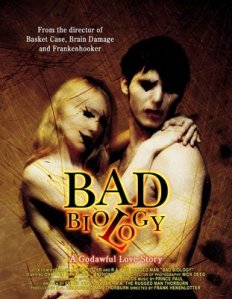Carnets Fantasia 2008 : samedi 12 juillet
Fin de semaine nipponne en perspective : trois films japonais au menu aujourd’hui, et trois autres demain! Indigestion de pellicule japonaise en perspective? Nulle crainte à y avoir, cette cinématographie étant l’une de mes préférées.

Velvet Hustler (Tohio Masuda, Japon, 1967)
On débute avec un des trois films sélectionnés par les organisateurs du programme intitulé « No Borders No Limits: 1960s Nikkatsu Action Cinema », qui nous permet de découvrir des perles inconnues des années soixante, une période faste pour ce studio spécialisé dans le film de genre stylisé, empruntant des codes cinématographiques au western, au film noir et même à la nouvelle vague française. Les cinéphiles occidentaux connaissent les œuvres de Seijun Suzuki, mais ils n’ont pas véritablement eu la chance de voir d’autres fleurons de cette époque, car ces films n’ont pas été distribués à l’extérieur des frontières japonaises, pas même dans les festivals. Une lacune que cette rétrospective itinérante nous permet de combler, en compagnie de Marc Walkow, programmateur du New York Asian Film Festival et spécialiste du genre, qui vient présenter le film, en plus d’ajouter les sous-titres en direct!
Son introduction riche en anecdotes et en détails informatifs précède la projection de Velvet Hustler, un étrange hybride de film de gangsters, de comédie et de romance dans lequel une vedette de l’époque, Tetsuya Watari, incarne une petite frappe prétentieuse et arrogante trouvant refuge dans la ville de Kobe, où il cherche à échapper à un assassin, tandis qu’il cherche à séduire une mystérieuse et insaisissable jeune femme. Longtemps demeurée introuvable, même au Japon, cette curiosité étonne par sa facture moderne, ses personnages excentriques et sa fusion des genres. Pas mal du tout, notre curiosité est piquée.

The Shadow Spirit (Masato Harada, Japon, 2007)
Restons dans la nostalgie avec un autre film japonais récent qui, lui, tente de recréer une époque révolue avec un parfum de désuétude assumée. Aucun risque de se tromper en affirmant que le récit du nouveau film du réalisateur de Bounce Ko Gals et de Kamikaze Taxi est compliqué. Ce serait même un euphémisme, tant The Shadow Spirit se dérobe sous nos yeux à force d’échafauder une structure narrative schizophrène, qui devient proprement impossible à démêler au bout de vingt minutes, et qui n’en finit plus ensuite de cultiver une opacité de plus en plus soûlante et inextricable, mais bizarrement fascinante, voire captivante.
En 133 minutes remplies à ras bord de coups de théâtre à répétition et de revirements dramatiques qui se succèdent plus rapidement qu’on ne peut les compter, Masato Harada parvient à articuler une quantité confondante d’intrigues qui empruntent au polar, au thriller, au fantastique et à la science-fiction. Je serais bien embêté de tenter de résumer ce film inclassable, un curieux exercice rétro très habilement mis en scène mais qui semble sorti tout droit du passé, en l’occurrence les années cinquante, reconstituées avec élégance. Le cinéaste s’amuse avec tous les genres possibles pour mieux nous jeter dans un état de perplexité continuelle. Heureusement, ça fonctionne, comme par miracle.
Cette démonstration absolument virtuose compte plusieurs moments d’humour réussi et mise sur les excellentes performances de ses acteurs, qui s’en donnent à cœur joie avec ce matériel, en particulier le merveilleux Shin’ichi Tsutsumi, un habitué des films de Sabu qui compose un personnage savoureux. Ceci fait en sorte que l’aventure demeure passionnante, en dépit du fait qu’on ne comprenne jamais véritablement où ce joyeux navire bordélique s’en va. Si les intrigues tarabiscotées à l’excès ne sont pas votre tasse de thé, on vous conseille d’éviter à tout prix. Mais les cinéphiles curieux qui sont avides d’expériences cinématographiques sortant de l’ordinaire seront ravis de découvrir que celle-ci l’est, complètement et indubitablement, au point de constituer un véritable défi lancé à vos repères filmiques. Ce n’est pas rien, mais il faut être diablement en forme et être prêt à sortir avec la tête pleine de points d’interrogation.

Shamo (Soi Cheang, Hong Kong, 2008)
Après une telle leçon de complexité cinématographique, on est à peine surpris de se retrouver au ras de la moquette avec Shamo, un lamentable exemple de médiocrité scénaristique que l’on tente de maquiller avec un beau vernis stylistique qui se veut trash. Peine perdue.
Aux commandes, on retrouve pourtant Soi Pou-Cheang, un cinéaste qui nous a donné quelques très bons films de genre récents en provenance de Hong Kong (dont Dog Bite Dog, vu à Fantasia en 2007). Mais cet habile faiseur est capable du meilleur comme du pire, souvent dans le même film, et ici, c’est le pire qui l’emporte largement, avec des rebondissements narratifs risibles et une lassante propension à essayer de nous en mettre plein la gueule à chaque seconde.
Dans cette sempiternelle variation sur le pauvre criminel au cœur brisé qui tente de donner un sens à sa vie en devenant champion de boxe – un concept usé à la corde, c’est le moins que l’on puisse dire – il trouve systématiquement refuge dans les effets poseurs qui gâchaient la dernière partie de Dog Bite Dog, son film précédent, nettement supérieur. Ici, il sacrifie encore plus rapidement un début assez prometteur et une ambiance glauque bien travaillée en privilégiant une esthétique tape-à-l’œil et un recours au mélodrame qui vire carrément au ridicule, tant les personnages sont réduits à l’état de caricatures informes. Le récit accumule les faux pas avant d’en rajouter avec une finale maladroite dont la nullité nous cloue sur place. Un peu plus et on criait bouh.

Tokyo Gore Police (Yoshihiro Nishimura, Japon, 2008)
Heureusement, ce n’était pas fini. Oh que non. Le clou de cette soirée a semé l’euphorie collective et entrera dans les annales du festival. La représentation de Tokyo Gore Police en séance de minuit était l’un des événements les plus attendus de cette douzième édition, et sans l’ombre d’un doute, on peut ranger cette projection parmi les moments magiques et inoubliables de l’histoire du festival. Le théâtre Hall était rempli à craquer pour assister à ce déferlement de folie furieuse sanguinolente.
On aura rarement vu une projection de minuit aussi courue – il y avait même des gens assis dans les allées. L’atmosphère était électrisante, et Mitch Davis a déclenché un véritable incendie de délire lorsqu’il est venu présenter les artisans du film : Yoshinori Chiba et Yoko Hayama, les producteurs, Tak Sakaguchi, concepteur des chorégraphies du film et acteur fétiche depuis Versus, le réalisateur Yoshihiro Nishimura, spécialiste des effets visuels qui a déjà travaillé pour Sion Sono, et qui signe avec Tokyo Gore Police son premier long métrage, et enfin, la plus attendue des fans, l’actrice Eihi Shiina, l’inoubliable madame « kiri kiri kiri » de Audition. De la visite royale, qui a reçu un accueil complètement hystérique de la part d’une foule enthousiaste jusqu’à la transe. Quel moment formidable. Et le film n’était même pas encore commencé!
La table était mise, et ce qui a suivi, c’est un buffet grandguignolesque de couleur rouge qui a dégouliné jusque dans la salle. Une virée grandiose au cœur de la démence cinématographique la plus jubilatoire qui soit. Le gore était à l’honneur, et pas à peu près, noyant même la lentille de la caméra à de multiples reprises. Mais contrairement à Machine Girl, dont le seul intérêt réside dans la multiplication des séquences répulsives et grotesques, Tokyo Gore Police a du style à revendre, une atmosphère du tonnerre (aidée par une excellente musique), des idées cinématographiques brillantes et un propos social incisif pour appuyer cette hémorragie filmique incontrôlée.
Dans ce récit futuriste déjanté, les forces policières ont été privatisées à Tokyo, où règne une terreur sociale alimentée par les « engineers », des mutants criminels que tente de contrecarrer le personnage incarné par Eihi Shiina, elle-même en proie à des pulsions violentes contradictoires qui sont alimentées par un passé traumatique.
Il y a de tout dans cette orgie sensorielle anarchiste : des mutations génétiques carnavalesques qui évoquent le David Cronenberg première manière, des combats cathartiques qui virent au carnage, et surtout, des parodies de publicités télévisées d’une méchanceté savoureuse. Ces bijoux d’humour noir corrosif comptent parmi les meilleurs moments du film, rehaussent le niveau d’un cran et évoquent les films d’anticipation de Paul Verhoeven.
La foule a également droit à ce qu’elle attend – du gore, encore du gore, des prouesses barbares spectaculaires, des démembrements et des éviscérations, à ne plus savoir quoi en faire. Et la représentation s’achève dans la jubilation manifeste des spectateurs. Le tout se termine très tard, après une période de questions-réponses où le réalisateur apparaît dans un costume hilarant, prothèse en main, tandis que Tak Sakaguchi insiste pour effectuer une démonstration de son talent acrobatique – mais pourquoi pas, Tak, vas-y! Grisés par ce succès, les invités signent des autographes et posent généreusement en compagnie de fans survoltés. Le festival pourrait s’arrêter ici, on est comblés. Mais allons dormir quelques heures, ça reprend demain, et on n’est qu’à mi-chemin, beaucoup d’autres délires nous attendent!